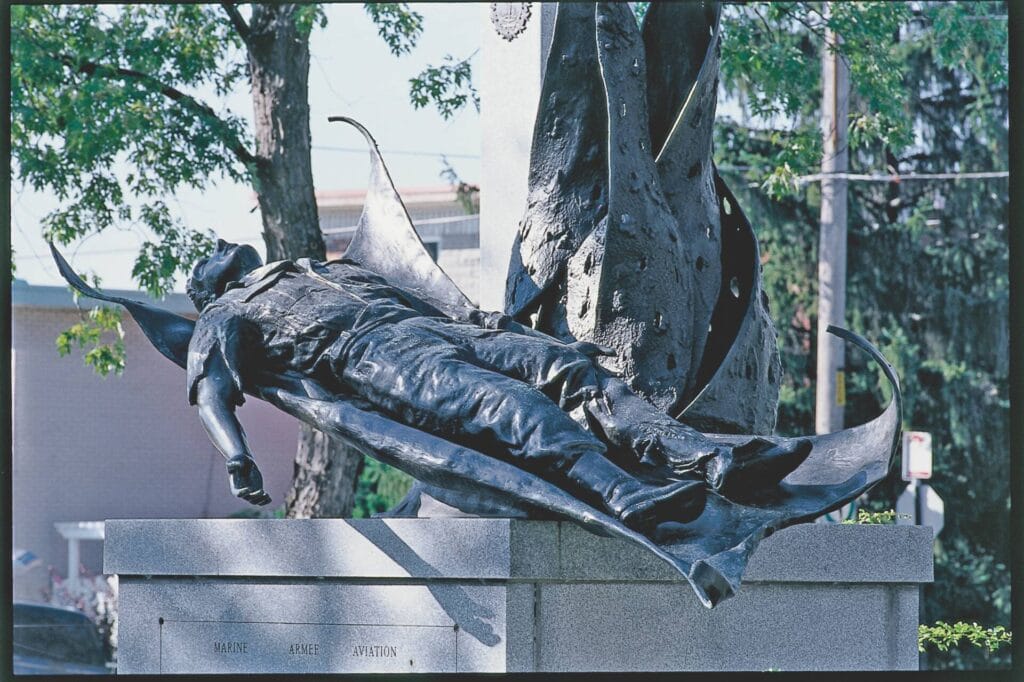Historienne et recherchiste
La mort empirique
L’écriture épigraphique signalant la mort du disparu évoque les concepts du repos et du souvenir. Le syntagme « Ci-gît » connaît peu de faveur et persiste jusqu’au début du XXe siècle et le « Ici repose » est utilisé surtout au XIXe siècle. Les expressions conventionnelles « À la mémoire de », « À la douce mémoire de », « En mémoire de », « In memory of », « In memoriam », « Sacred to the memory of » et « Memento » voisinent les données d’identification telles que noms, dates et état civil. Ces inscriptions ont peu à peu remplacé le « Ici repose » et le « Ci-gît », pour mieux concurrencer le leitmotiv pieux « R.I.P. ». Les deux formules sont gravées au même moment : en haut, « À la mémoire de » sert de prologue et au bas, « R.I.P. » s’affiche comme épilogue. Elles connaissent une évolution similaire et leur courbe d’utilisation culmine entre 1880 et 1900, se maintient entre 1900 et 1920 et s’éclipser peu à peu à partir du milieu du XXe siècle. Les épitaphes anciennes super posent l’âge du défunt à la date du décès – et ce, jusque vers le milieu du XXe siècle – ou encore, elles précisent le lieu ainsi que les jours de naissance et du décès. La mort s’envisage au présent, car le défunt est là : « Ici repose le corps de Sieur Siméon Béland […]. » En soulignant l’état du corps, cette mort actualisée devient étrange : « Ici reposent les restes mortels des S.S. Madeleines du Bon Pasteur de Québec. » Parfois, la mort sur le Vieux Continent s’associe à la fonction de l’époux :
Dr Florant Bernier
décédé le 7 octobre 1951 à 49 ans
son épouse
Marie-Anne Landry
décédée le 7 octobre 1951 à 50 ans

La mort métaphorique
La mort défie le temps pour exprimer la vie et par là, permet de vaincre l’abîme. La joie se manifeste sur la petite stèle du lot familial de Charles Sharples :
William Sharples
born June 15, 1861
died September, 1929
« in the presence is fulness of joy »
[dans la plénitude de la joie]
Pour Thomas Pope, mort au poste, le meilleur reste à vivre :
Sacred
to the memory of
Thomas Pope, advocate,
who died
on the 29th june 1863
while filling for third consecutive
year the office of mayor of Quebec;
aged 37 years
«Thy will be done»
[Désormais, que le meilleur lui soit fait]
« Mourir c’est vivre » fut gravé au haut de la stèle d’Eudore Papillon, à l’occasion de la mort de Jean-François, en 1953. Les parents assurèrent la veille, car leurs noms furent gravés en même temps, le père l’ayant ensuite rejoint en 1990. Cette inscription surmontée d’une croix peut s’interpréter comme une ancienne « image chrétienne de la naissance nouvelle, du dies natalis » (Boglioni : 281). La désignation du trépas évoque souvent la mort-repos, projection de l’image du sommeil. « La métaphore permet à l’endeuillé d’énoncer indirectement, sans sourciller, la proposition paradoxale ce mort est vivant car le sommeil c’est encore la vie ! » (Urbain 1978 : 213).
La mort tragique
La joie côtoie la tragédie. La mort accidentelle, qui fauche la vie, appelle à l’évocation des circonstances. Il s’agit d’un événement inattendu et trop souvent précoce, comme c’est le cas pour le fils de Philippe Bazin : « J. Elzéar Gustave noyé accidentellement le 20 juillet 1900 à l’âge de 16 ans » ou celui du pilote J. Adélard Bernier : « Raymond 1920-1941 / disparu en mer sur S/S Nereus. » Afin de mieux dire la mort tragique, le récit s’allonge et il s’associe ici à Notre-Dame de La Salette figurant en pleureuse :
Odila Doré
1889-1950
épouse de
Joseph Clermont
morte dans l’écrasement
de l’avion pèlerin canadien
sur l’Obiou, Alpes, France
le 13 novembre 1950
au retour d’un pèlerinage
à Rome

La mort héroïque
Le jeune soldat, mort en fonction, est perçu comme un héros. Sur l’obélisque de la famille de Jean-Baptiste Renaud, il figure après ses parents :
[…] Jean Louis Renaud
mort au Tonkin
au service de la France
le 4 janvier 1887
à l’âge de 29 ans.
Le fils de Benjamin Martin Jr, quant à lui, occupe le sommet de la liste :
À la mémoire de
W.J.J. Martin
mort au champ de bataille en France
le 2 nov. 1916 à l’âge de 19 ans. […]
L’officier a droit à une stèle se distinguant par son motif unifolié, offerte par la Commission impériale des sépultures de guerre constituée en 1917 :
Lieutenant Colonel
Édouard A. Lebel
Serv. de santé, F.E.C.
19 janvier 1925
Officier
de la Légion d’honneur
mort pour la patrie
Il bénéficie d’une deuxième inscription, cette fois, sur le monument familial :
Édouard Albert Lebel
1866-1925
Son épouse Eva Balza Retti
1879-1954
Lucille 1905-1920
Si les familles exaltent les mérites de leur héros, l’État leur voue un culte civique avec les deux monuments aux morts érigés sur l’avenue des Combattants aux confins ouest du cimetière, près desquels flottent la bannière canadienne :
1914 † 1939
1918 † 1945
Morts pour la patrie
les hommes ci-honorés
sont inhumés
dans ce cimetière
Those honoured here
died in the service
of their country
and lie elsewhere
in this cemetery
Sur chacun d’eux, les noms des militaires s’empilent de part et d’autre du texte et tel qu’indiqué, ces soldats sont inhumés ailleurs, sur les lots de leur famille :
Par égard aux souffrances
qu’ils ont endurées et aux
blessures qu’ils ont subies
au cours de leur service
militaire, les personnes
ci-honorées ont été inhumées
par le gouvernement du Canada
Elles reposent ailleurs dans ce
cimetière
Out of consideration for the
hardship or injury born of
their military service those
here commemorated were interred
by the government of Canada
they lie elsewhere
throughout this cemetery


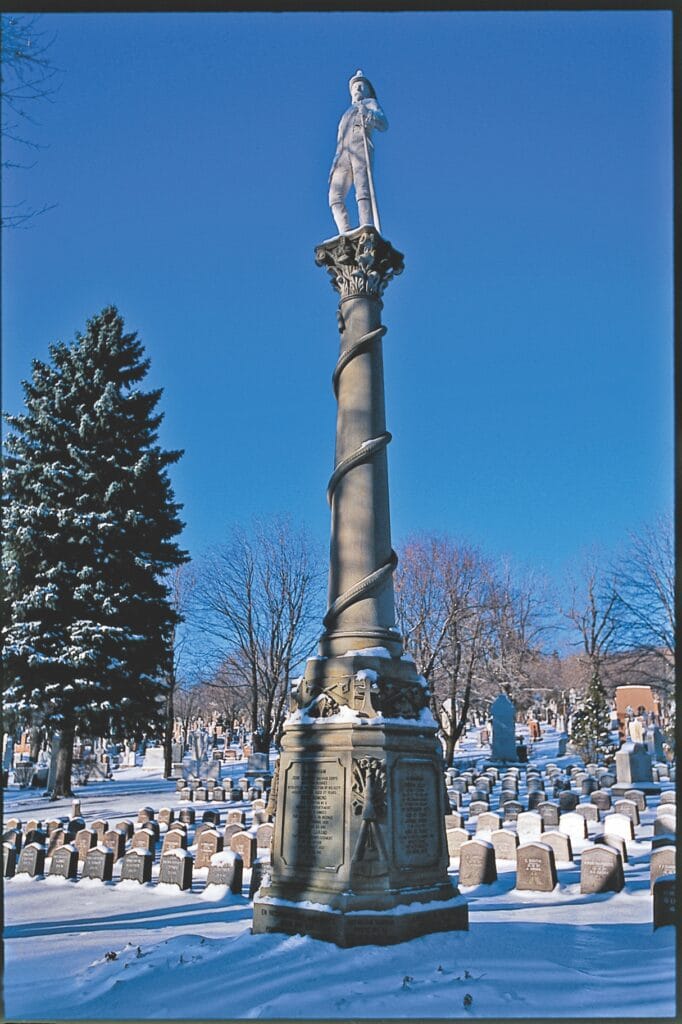
Par ailleurs, la communauté vietnamienne se souvient de ses compatriotes morts au champ d’honneur. Elle souligne la valeur de leur geste patriotique et leur voue un hommage en version bilingue transcrit sur une plaque en métal au bas d’une stèle verticale affichant la silhouette d’un soldat assis sur un tronc près de l’étendard national, casque en tête et sac au dos : « À la mémoire / Des combattants des / forces armées de la / République du Viet Nam / qui ont sacrifié leur vie / dans la lutte / contre le / Communisme / pour sauvegarder / la liberté du Sud Viet Nam / de 1945 à 1975. »
Note (1)
Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.