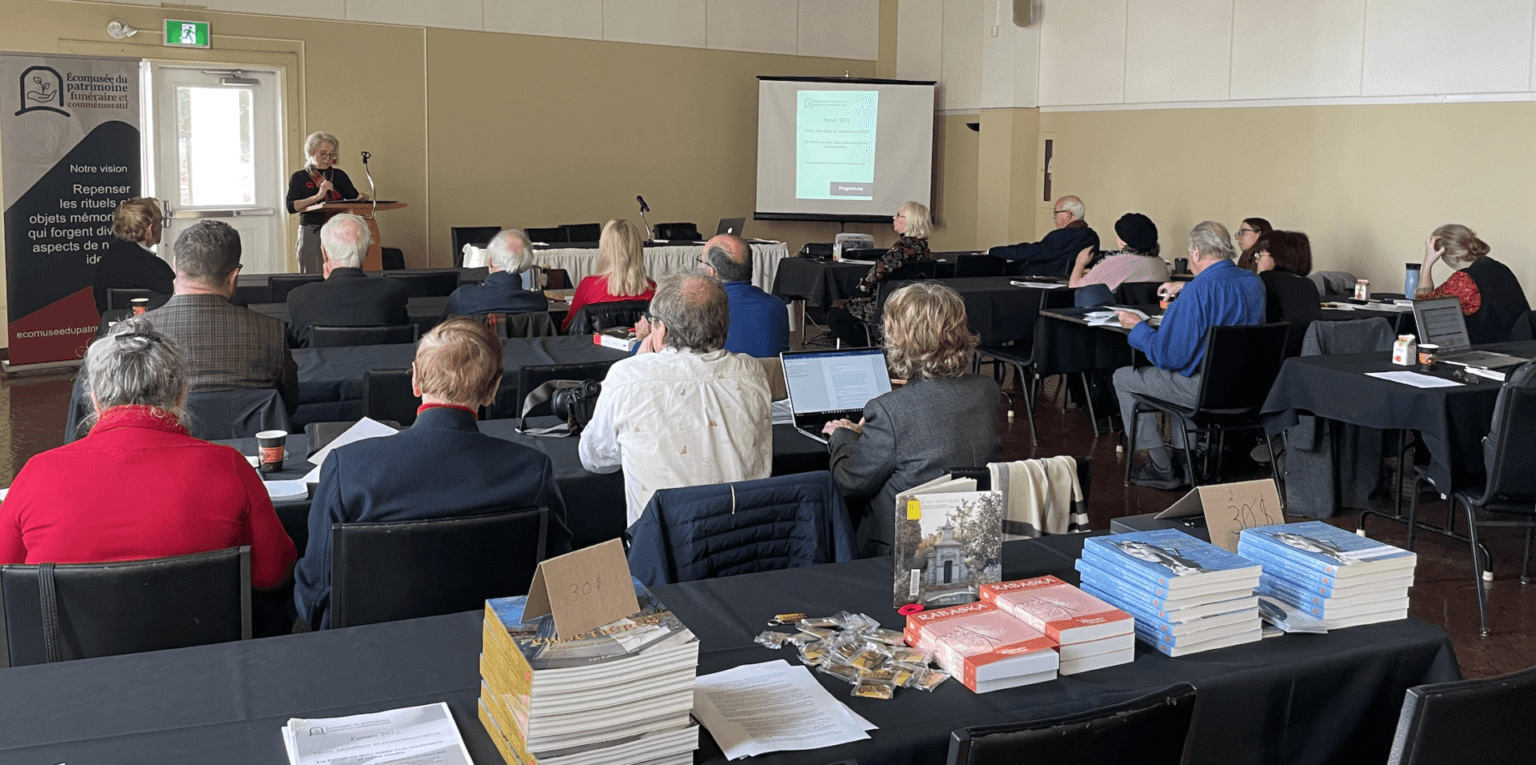Le deuxième temps de notre Forum 2022 s’est tenu à Québec le 11 novembre. Il s’est déroulé avec autant de réussite que celui ayant eu lieu à Montréal le 28 octobre et a été très profitable pour guider notre organisme dans la poursuite de sa mission.
Après le mot de bienvenue du président Daniel Lapierre et du Directeur Général Alain Arseneault, France Rémillard a résumé les conférences précédentes et exposé les sujets du jour orientés vers la commémoration nationale, régionale, municipale, communautaire, familiale et privée. Elle a pris soin d’annoncer qu’à 11h00, nous observerons 2 minutes de silence en souvenir du 11 novembre, anniversaire de l’Accord d’armistice de 1918 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Avec la distinction qu’on lui connaît, elle a présenté chaque conférencier et conférencière avant leur prestation.
Première Conférence
Conférence de Fernand Harvey, sociologue et historien
Commémoration et patrimoine : deux histoires parallèles
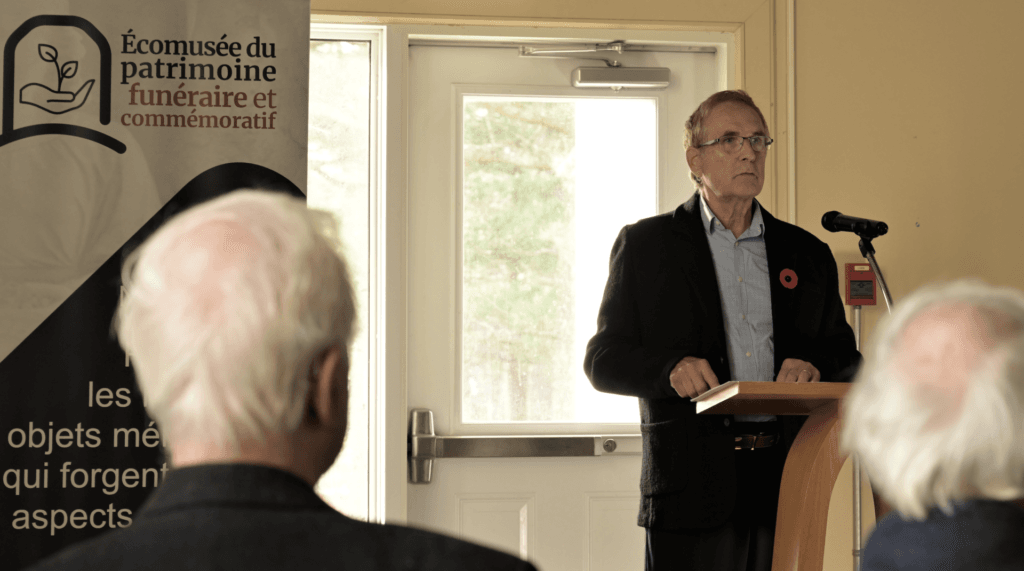
Le réputé sociologue et historien Fernand Harvey a ouvert les travaux de l’avant-midi en montrant comment la commémoration a évolué dans la ville de Québec. Son analyse a mis en lumière un premier mouvement débutant à la fin des années 1820 caractérisé par un dualisme où se profilait l’affirmation du Canada français au sein d’une société marquée par la conquête britannique. Entre les monuments des généraux Wolfe et de Montcalm, la translation des restes de Mgr Laval et l’érection des statues de héros sur la façade du Parlement, l’aspiration à célébrer Champlain plutôt que la bonne entente entre francophones et anglophones, des scènes religieuses et des figures politiques, se sont dessinées d’importantes divergences d’interprétation de l’histoire jusqu’à la deuxième guerre mondiale. À partir de 1940, s’en est suivie l’émergence d’une politique du patrimoine. La mise sur pied de la Commission des monuments historiques, inspirée par Athanase David, a contribué fortement à la prise de conscience du patrimoine bâti. On pouvait désormais exproprier dans un but de commémoration, on a restauré la place royale et les municipalités ont été invitées à sauvegarder des bâtiments. En somme, les lieux de mémoire ont relégué au second plan les monuments. Puis, est arrivé un second mouvement de commémoration à partir des années 1980. Alors qu’à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les autorités coloniales, les sociétés patriotiques, le clergé et les communautés religieuses se faisaient valoir tour à tour, cette fois, c’est l’État québécois qui a commencé à imposer sa vision. La création de la Commission de la capitale nationale par le gouvernement en 1995 y a participé largement. La colline parlementaire est devenue un secteur d’intervention prioritaire avec, entre autres, la promenade des premiers ministres, un Inukshuk, un ensemble sculptural représentant quatre femmes pionnières en politique. En plus de l’entretien des sépultures des premiers ministres, on a assisté à la mise en valeur d’un cimetière oublié : le cimetière général de Québec. Sans être un cimetière militaire, on a découvert que l’endroit contenait les restes de 1,000 soldats inhumés aux côtés des pauvres soignés à l’Hôpital général. L’occasion était offerte pour glorifier dans le même lieu le marquis de Montcalm et ses soldats et pour placer la commémoration au niveau international avec la guerre de sept ans.
Fernand Harvey a conclu que la commémoration était une négociation constante avec le passé. À preuve, elle a été marquée à Québec par des débats sur le choix des héros nationaux; un accent mis sur le patrimoine dans le sillon de la ferveur nationaliste; la prise en compte progressive des nouvelles sensibilités dans les domaines de l’éducation, de la santé, du bien-être social, des communautés culturelles; l’élargissement du patrimoine aux bâtiments, au paysage, au secteur industriel et au patrimoine immatériel; le rapprochement entre patrimoine et commémoration dans une quête de sens à la fois pour les habitants et les visiteurs de l’extérieur.
Deuxième Conférence
Conférence de Frédéric Smith, conseiller à la ville de Québec en matière de commémoration, de toponymie et de patrimoine
Commémoration à la ville de Québec
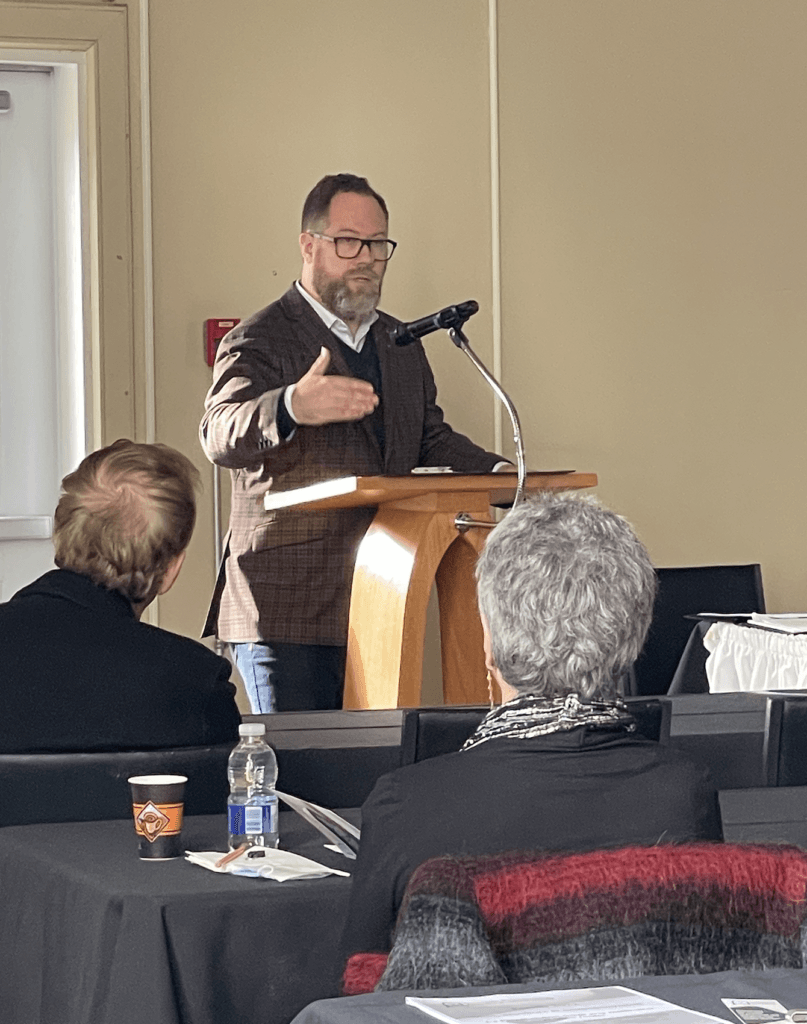
L’historien Frédéric Smith, conseiller à la ville de Québec en matière de commémoration, de toponymie et de patrimoine, lui a succédé au micro. Il a montré comment le cadre d’intervention en commémoration de la Ville fournissait des balises communes aux employés municipaux, structurait les interventions, en définissait les limites et améliorait leur cohérence et leur répartition géographique. Ce cadre s’est avéré particulièrement utile dans le contexte de de l’installation de plusieurs monuments par année à partir des années 1990. Avec la saturation de certains territoires, la compétition entre les sujets, le regroupement municipal dans les années 2000, il a fallu apprendre à travailler avec les acteurs du milieu et encadrer la participation des citoyens. Le 400e anniversaire de Québec 2008 a été propice pour mettre en relief sa relation aux nations étrangères et a donné lieu au dévoilement de nombreux cadeaux commémoratifs reçus de la part de différents consulats. L’historien a montré que la Ville devait interagir avec de nombreux joueurs : la Commission de la Capitale nationale, la Communauté métropolitaine de Québec incluant Lévis, l’Assemblée nationale, le Gouvernement du Canada, Parc Canada et, plus récemment, le Ministère de la culture et des communications avec la stratégie québécoise de commémoration. Il a fait remarquer que la Ville doit respecter différentes lois sur le patrimoine, s’entendre avec la Commission d’urbanisme, faire des demandes de permis, négocier des emplacements sur des terrains et nouer des partenariats avec le privé et des organismes privés à but non lucratif. Elle a aussi un rôle important à exercer dans les sujets qui se doivent d’être en lien avec son statut historique, faire consensus, évoquer les groupes et les domaines les moins bien représentés. Elle a la responsabilité de confier les œuvres d’art public à des artistes et respecter la loi du 1 %.
Elle met en place une variété de moyens : repère permanent, aménagement de la trame urbaine, manifestation commémorative, cérémonie de recueillement, spectacle, série Web Québec, scénette musicale et historique pour souligner des anniversaires (la présence d’un musicien étranger, le 100e anniversaire de l’incendie de la cathédrale, le 100e anniversaire de la grippe espagnole) ou faire des liens avec les événements récents, telle la COVID. Elle doit favoriser des lieux d’intervention en relation avec le sujet traité et veiller à un équilibre visuel avec l’environnement, malgré le fait que ce sont souvent des enjeux politiques qui influencent les décisions. Actuellement, un de ses défis principaux est d’éviter de surcharger le milieu et de réserver des espaces pour la génération future. Il lui faut aussi appliquer des critères de pertinence judicieux : importance significative du personnage ou de l’événement, en dehors d’une promotion commerciale, respect d’un délai raisonnable après le décès pour laisser les familles faire leur deuil et ne pas rendre hommage à une personne dont on pourrait découvrir trop tard les actions douteuses.
En conclusion, Frédéric Smith a reconnu que les organismes privés à but lucratif comme le nôtre jouaient un rôle important en commémoration en tant qu’ambassadeurs sur le terrain, même si la gestion relevait du Service de la culture et du patrimoine, exigeait la réunion de comités et de résolutions du conseil de ville, mettait à la disposition des citoyens des formulaires en ligne à la fois pour la commémoration et la toponymie. Il a souligné des réalisations qui ont nécessité la participation de plusieurs acteurs : le programme phare des Plaques Bleues ICI VÉCUT où ce sont de plus en plus les propriétaires des maisons eux-mêmes qui en font la promotion; la Place Jean-Béliveau, un lieu hybride d’art public et commémoratif autour du thème du hockey; le monument aux Pee-Wee représentant de jeunes garçons en bronze numérisés dans leurs équipements de hockey; le mémorial aux victimes des attentats de la mosquée à Ste-Foy; l’allée des poètes sur la rue d’Auteuil; la stèle hommage à Olivier Le Jeune dans la cour du séminaire, esclave arrivé avec les frères Kirke et donné au colon Guillaume Couillard, qui avait sa résidence dans la cour dudit séminaire; la plaque en hommage aux victimes du Vieux Québec le 31 octobre 2020, près de la Place d’Armes.
Troisième Conférence
Conférence de Maryse Dubé, collaboratrice à la revue Profil
Mémorial privé : Est-ce aidant ?

Maryse Dubé, collaboratrice à la revue Profil, a ensuite pris la parole. Dans sa communication, elle nous a fait sortir de la commémoration publique pour nous amener vers la commémoration privée. À la suite de la perte de son petit frère Sylvain, du comportement de la voisine qui a fait disparaître tous les objets ayant appartenu au bébé, de l’impact de cette mort sur sa mère qui a sombré dans la dépression, d’un cancer, Maryse Dubé a mis sur pied en 1998, avec son conjoint, un lieu d’entraide appelé La Gentiane, désormais partagé avec les coopératives funéraires. Son histoire l’a conduite à s’intéresser aux monuments commémoratifs d’événements traumatisants et elle en donne de multiples exemples. Au Mémorial du 11 septembre 2001 à New York, on a conservé un arbre qui a survécu à la catastrophe appelé Survival Tree, en écho à la perte personnelle et à l’espoir. Au Mémorial du 6 juillet 1973 à Lac Mégantic, 47 silhouettes ont été installées, en plus d’une 48e pour que chaque visiteur puisse s’identifier à ce symbole. Au Nouveau-Brunswick, sept jeunes joueurs de basketball sont morts avec l’épouse de leur entraîneur lors d’un accident de la route en 2008. 4 ans plus tard, leur école a choisi de leur rendre un hommage permanent avec une photo encadrée. L’épouse de l’entraîneur n’y apparaît pas, parce qu’on a voulu souligner la jeunesse qu’on perdait. Il existe des mémoriaux privés plus temporaires et improvisés. Pensons aux vélos sur le bord d’un trottoir avec un mot adressé au défunt; aux messages d’amour destinés aux proches; aux objets placés sur les lieux du drame (clé de voiture, ceinture, casquette, couronne, gerbe de fleurs, bouteille de bière, croix). Même si on retire ces objets après un certain temps, c’est bon pour la famille de savoir que d’autres personnes ont su qu’il y avait eu un décès à cet endroit.
On se pose souvent la question à savoir si des rituels intimes et un espace dédié à la mémoire du défunt sont nécessaires. À la fin des années 1950, il n’y avait pas de crémation. La famille de la conférencière était pauvre, elle partait du Bas St-Laurent, elle n’avait pas d’argent pour l’inhumation du bébé décédé. Il a été enterré dans la fosse commune et on refusait de dire où il était. À la maison, il n’y avait pas d’autel, on n’en parlait pas, on soulignait sa naissance, mais pas son décès en février. On le savait parce que la mère faisait une dépression à chaque année à ce moment-là. À 90 ans, dans un Centre de personnes âgées, alors qu’elle parlait de suicide, elle a pu s’exprimer au sujet de la mort de Sylvain auprès de quelqu’un et elle a reçu le soutien approprié. Il existe beaucoup de rituels privés maintenant. Quand est-ce aidant ? Lorsqu’ils assurent une période de transition qui permet d’apprivoiser l’absence physique; créent un espace de souvenirs, de partages, de confidences; invitent à des rites familiaux lors de moments importants. Même en cas de dispersion des cendres, si les endroits deviennent des lieux de mémoire, cela permet d’apprivoiser l’absence. Quand est-ce nuisible ? Lorsqu’il y a privatisation des cendres et que les personnes qui ont connu le défunt n’y ont pas accès; lorsqu’il y a un espace pour les cendres imposé dans la maison, alors que les autres peuvent en souffrir; lorsque cela empêche de faire son deuil.
En conclusion, la conférencière pose la question : sa mère aurait-elle fait une dépression si elle avait eu accès à des repères commémoratifs ? Elle en aurait sans doute fait une, puisqu’elle a perdu son fils pendant qu’elle était enceinte. Mais, avec de l’aide, elle serait arrivée à tenir le coup et les autres membres de la famille n’auraient pas perdu leur maman.
Table ronde des trois premières conférences

Une table ronde a suivi ce premier cycle de trois conférences. Elle a été animée par Alain Tremblay, président-fondateur de l’Écomusée du patrimoine funéraire et commémoratif. Ce dernier a expliqué que son organisme était passé du funéraire au commémoratif afin de mieux préciser sa mission initiale. Il a déposé le projet de déclaration finale défini à la suite du premier temps du Forum tenu à Montréal le 28 octobre et il a ouvert les débats pour l’enrichir. Ces derniers ont porté sur :
- Les circonstances spécifiques qui créent des lieux commémoratifs privés
- Les choix faits par les commissions historiques du Québec et du Canada pour déterminer des lieux commémoratifs publics (lieux militaires, bâtiments qui rappellent des événements ou des éléments du patrimoine, gare patrimoniale, plaines d’Abraham).
- La notion de responsabilité civile lorsqu’une ville intervient sur des bâtiments privés (les plaques bleues visibles depuis la voie de communication ou relativement proches du trottoir ou dans des entrées privées ou dans des banlieues qui exigent un certain retrait et la signature de toutes sortes de contrats concernant les blessures potentielles dans des escaliers enneigés)
- Le mariage entre la propriété privée et la propriété publique qui limite les lieux d’intervention et les lieux de juridiction qui colorent les interventions
- L’hésitation du gouvernement à faire reconnaître les cimetières comme des lieux de commémoration
- La distinction à faire entre un lieu accessible au public (un cimetière, un lieu privé appartenant à une corporation) et un lieu collectif public (un parc urbain, un espace appartenant à une municipalité)
- Le fait que le patrimoine funéraire ne soit pas mentionné dans les municipalités, car il ne leur appartient pas
- Le type de partenariat que cela exige pour agir dans les cimetières (les sépultures des anciens premiers ministres)
- Les différentes interventions gouvernementales faites dans les cimetières (la restauration coûteuse du caveau de la famille d’Honoré Mercier; les mises en valeur pour les promeneurs; les repères signalétiques; le vocabulaire funéraire; la représentation des visages des premiers ministres; les mentions que le monument est entretenu par la CCNQ)
- Le fait d’investir également pour chaque premier ministre, alors que leurs contributions et leur temps en fonction n’ont pas été semblables
- L’honneur accordé à la fonction plutôt qu’à la personne
- La prise en compte de l’évolution de la commémoration dans le temps et du choix des familles dans les monuments (monolithe pour Robert Bourassa à Montréal, pierre commune pour René Lévesque à Sillery)
- Le travail de recherche et d’interprétation pour faire connaître les élites locales et régionales souvent méconnues dans les cimetières (travail actuel de Bernard Genest à Sherbrooke))
- Les difficultés rencontrées lorsque les familles ont déjà fait des travaux majeurs de réfection (qui ne résistent pas toujours aux épreuves du temps, parfois maladroites sur le plan de la restauration, qui nécessitent d’être défaites et refaites)
- Les difficultés d’une surveillance constante ou d’entretien à long terme
- Le langage des symboles et des écritures épigraphiques, un grand oublié
- Le rôle essentiel de l’inventaire et de la mise en valeur de ce qui existe déjà dans le paysage urbain
- La nécessité d’interpréter le patrimoine en termes narratifs, le gros défi des prochaines générations qui ne s’intéressent plus à l’histoire du Québec; on note que les professeurs commencent souvent par le nom de leur école pour capter l’attention de leurs élèves
- La nécessité de travailler avec les sociétés d’histoire pour valoriser les hauts lieux de commémoration que sont les cimetières
- Le besoin pour les gens de comprendre à quoi cela sert les funérailles, dans un contexte de l’aide à mourir et de la possibilité de conserver les cendres chez soi
- Le besoin de faire participer activement les familles à la préparation des cérémonies
- La possibilité de commémorer les 58 patriotes déportés en Australie et honorés par des monuments là-bas, mais pas ici sur le territoire (plaque pour honorer le patriote Joseph Marceau, originaire de Bellechasse, qui pourrait être installée proche de son lieu de départ pour l’exil)
- L’importance de faire des recherches historiques avant d’honorer des victimes politiques ou des sujets oubliés (documentaire qui dure 1 heure et demie sur les Patriotes déportés en Australie en 1839, graciés par le gouvernement de l’Union en 1844)
- Le souci de ne pas saturer un haut lieu de commémoration (St-Denis-sur-Richelieu)
- La différence entre la commémoration et un projet pédagogique
- L’obligation ou non d’obtenir des consensus avant d’agir pour éviter les contestations futures (Champlain, Patriotes, Papineau, Wolfe, expropriation à Mirabel)
- La commémoration des cimetières parce qu’ils font partie du paysage patrimonial
- Le besoin de faire des inhumations plus environnementales pour leur mise en valeur
- Le danger de virage écologique qui pourrait compromettre leur patrimoine paysager (Notre-Dame-Des-Neiges)
- Les astuces et les occasions pour faire connaître le patrimoine des cimetières aux écoliers (activités ludiques, visites fantôme, fête victorienne, mois des morts, contes et légendes d’histoires locales, écoute des enregistrements avec le code QR sur les monuments ou des commémorations virtuelles)
- L’inventaire des anciennes manifestations commémoratives (au parc Jeanne d’Arc, en mai, la haute société se réunissait autour de la statue équestre pour célébrer la plantation du mai, un arbre ébranché jusqu’au sommet; de pareilles fêtes avaient lieu à Beaumont, à Bellechasse, etc., et étaient accompagnées de tirs de nombreux coups de fusil qui noircissaient le tronc)
- L’inventaire des manifestations commémoratives virtuelles et de leurs avantages (message explicites adressés à la personne décédée durant la pandémie).
Quatrième Conférence
Conférence de Anne-Marie Poulin, ethnologue
Springbrook : Forget-me-not
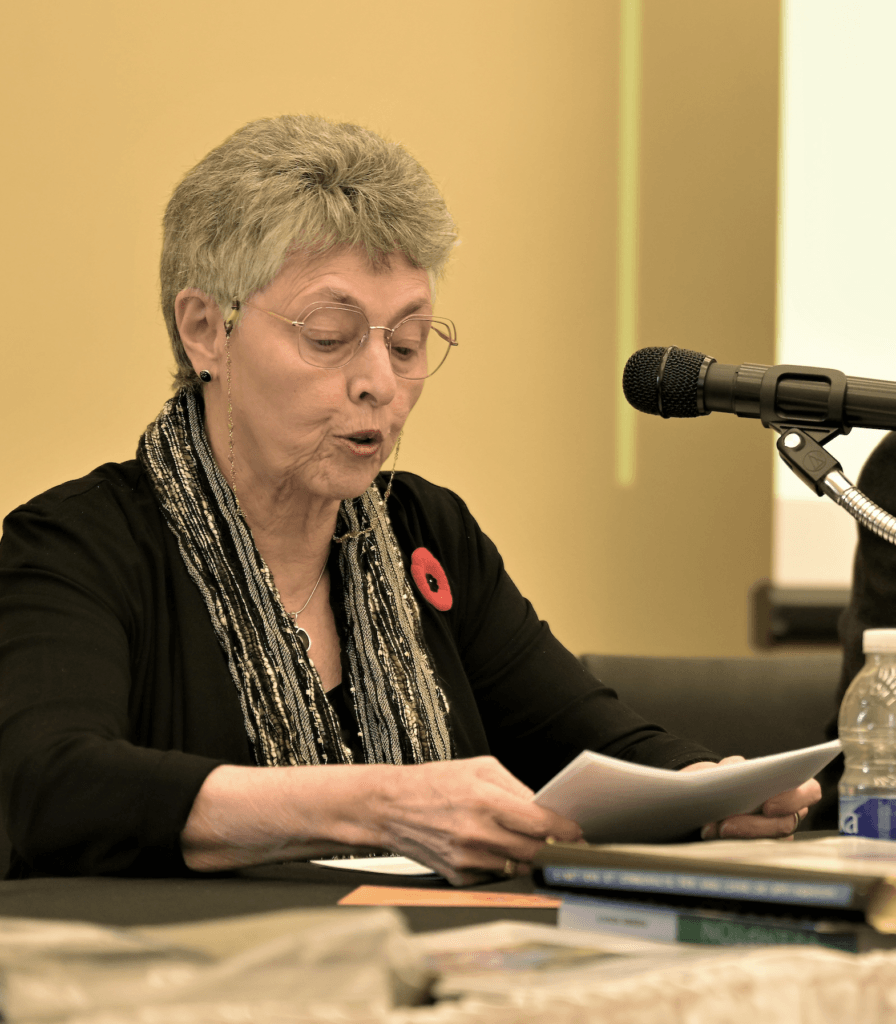
Le deuxième cycle de conférences a débuté dans l’après-midi par celle d’Anne-Marie Poulin, une ethnologue franco-ontarienne. Entre 1986 et 1989, elle s’est intéressée à Springbrook dans le canton de Frampton en Beauce. Son objectif initial était de décoder les significations sociales du cimetière de cette petite communauté anglicane constituée au début du XIXe siècle et dissoute en 1952. Elle voulait mettre en valeur les familles, les personnages et le mode de vie de ce groupe co-fondateur du canton. Après avoir situé le hameau de Springbrook sur la route 216 entre Frampton et Saint-Malachie, elle décrit la situation minoritaire de ces anglicans face à leurs compatriotes Irlandais catholiques et face aux Canadiens français arrivés massivement au cours des années 1850. Le plan cadastral de 1884 illustre la répartition des terres selon l’appartenance ethnique et confessionnelle : anglicans 10,8%, Irlandais catholiques 41,4%, Canadiens français 47,8%. Vers 1900, Springbrook comprenait un îlot paroissial avec chapelle et cimetière, un ensemble de bâtiments appelé parsonage où se trouvaient la maison du pasteur avec les dépendances usuelles de l’époque, l’école de jour et le bureau de poste. Les terres de la majorité des familles anglicanes formaient comme un demi-cercle autour de l’îlot. Le parsonage était alimenté en eau par une très belle source qui a donné son nom à l’endroit. Le temple Christ Church de Springbrook et son cimetière demeurent jusqu’ici les témoins les plus accessibles de leur présence. Le temple a été bâti en pierre des champs, selon l’ancien style canadien avec un toit à 3 versants. En 1896, on y a ajouté une tour-clocher en bois, un élément architectural essentiel pour les anglicans. En 1906, jugé disgracieux, le toit a été modifié pour essayer d’éliminer ce qui ressemblait à une architecture canadienne, passant de 3 à 2 versants. Restauré en 1985-1986, il a été refait à trois versants. Quant au cimetière, le relevé onomastique des 88 pierres tombales encore debout a permis d’établir que la majorité des chefs de familles souches anglicanes y reposaient; que plusieurs anglicans étaient d’origine irlandaise; que les femmes mariées issues des familles souches étaient inhumées dans leur famille d’origine, et non pas avec leur mari. Fait rare pour un anglican, un des 7 violoneux a choisi d’être inhumé sous l’église avec son violon. Seules deux généalogies familiales ont pu être établies avec précision, compte tenu des prénoms semblables. Mais leur reconstitution a confirmé le rôle important des familles pionnières au plan religieux, social et civil. Un album d’autographes a aussi permis d’illustrer l’importance de leurs réseaux d’alliance, leurs liens d’affection, leur humour et leur souhait de ne pas être oublié par la mention récurrente Forget-me-not.
L’ethnologue a retracé leur patrimoine religieux et social qui a rayonné sur les environs. La communauté se démarquait aussi par la musique et la danse. Parmi les 40 violoneux du canton, 7 étaient des virtuoses anglicans qui animaient des « sets carrés » à l’occasion de leurs house parties. Mais, l’événement le plus mémorable était leur garden party, une fête annuelle organisée pour soutenir les oeuvres de la paroisse. Outre les jeux d’adresse, courses, etc., il tirait principalement bénéfice du tirage d’une courte pointe collective où se trouvait brodé en rouge le nom de chaque souscripteur. Très tôt, ce travail de levée de fonds par des femmes anglicanes a pris une dimension régionale, multiethnique et multiconfessionnelle. Ainsi, en 1917, des 377 noms brodés, 267 renvoyaient aux anglicans, les autres étant des catholiques – Irlandais et Canadiens – contribuant à financer une école privée protestante dans leur milieu. 35 ans après le départ des anglicans, en 1987, la tradition de la courte pointe brodée a rejoint plus de 700 personnes. Au centre figurait le thème : Forget-me-not/ne m’oubliez-pas.
En conclusion, Anne-Marie Poulin a montré que cette petite communauté a laissé des traces de sa présence à la fois dans l’histoire et le paysage. La semence de myosotis dans toute l’aire sacrée par les dernières familles ayant quitté en 1952 rappelle le vœu de tout groupe, si petit soit-il : ne pas être oublié. L’auteure a distribué à chaque participant-e la brochure Un héritage anglican. L’église Christ Church à Frampton, 1989.
Cinquième Conférence
Conférence de Brigitte Garneau, anthropologue et auteure
Des généalogies de familles menant aux pierres tombales de la Nouvelle-Angleterre
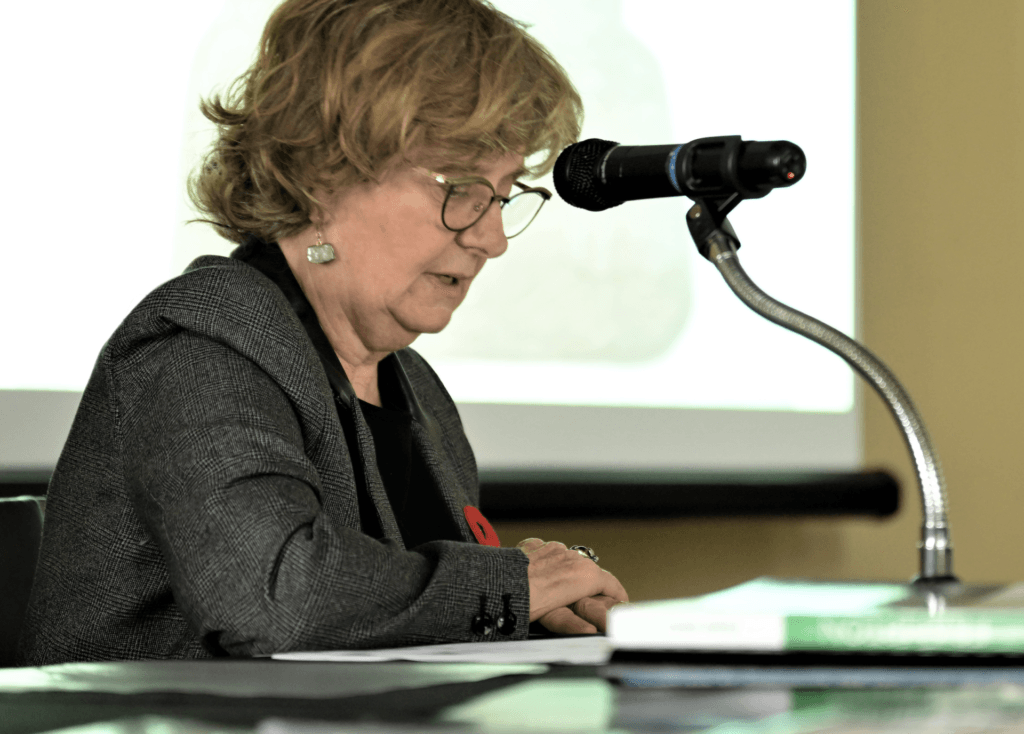
Ce fut ensuite au tour de Brigitte Garneau, anthropologue, de faire sa présentation. À partir de documents qui lui ont été légués par une tante célibataire, elle a reconstitué l’histoire de familles de cultivateurs ayant peuplé la région Chaudière-Appalaches. Les généalogies traditionnelles se résument à la filiation descendante à partir d’un ancêtre, de père en fils, avec la date et le lieu du mariage du chaînon reproducteur, ainsi que le nom de son épouse. Par opposition, les généalogies de familles ont, selon elle, un pouvoir commémoratif insoupçonné. Ainsi, le premier tableau généalogique qu’elle a examiné contenait : a) l’identité de tous les enfants morts en bas âge avec leur date précise de naissance et de décès; b) les dates de naissance de tous les enfants mariés, ainsi que celles de leurs conjoint-e-s; c) l’identité des conjoint-e-s des veufs et des veuves. Du coup, il lui a été possible d’avoir un aperçu de la famille de ses arrière-grands-parents paternels mariés à Ste-Croix de Lotbinière en 1868 : naissance de 17 enfants, dont 11 seulement survivront jusqu’à l’âge adulte; épousailles de tous les 11 enfants; mariage tardif de 4 des 5 filles et d’un garçon; histoires de vie marquées par la surmortalité des jeunes mères; courtes périodes de veuvage; remariage de mamans et de papas avec de jeunes enfants à charge. Les données sur la progéniture de 7 de ces 11 enfants l’ont renseignée sur plus de 160 individus reliés les uns aux autres par filiation ou alliance.
Un deuxième tableau lui a permis de découvrir tout un pan de la vie de ses grands-parents paternels tenant une beurrerie et une fromagerie. Établis à St-Martin de Beauce en 1901, ils y ont eu 15 enfants, 10 garçons et 5 filles, dont 14 ont survécu. On a consigné pour chaque enfant : a) l’ensemble des prénoms reçus au baptême; b) leur lieu de naissance; c) les dates de naissance et le lieu de mariage de leurs conjoint-e-s; d) l’identité des premiers et des seconds conjoints des veufs et des veuves; e) les dates d’entrée en religion de deux d’entre eux. Cette fois, on remarque : l’enracinement des enfants dans le village, puisque 7 garçons et une fille ont conclu des alliances matrimoniales avec une ou un partenaire originaire du même lieu; le célibat de 4 des 5 filles; la transmission du prénom du père à celle entrée chez les Sœurs de la Charité de Saint-Louis en 1923 et du prénom du frère aîné au garçon ayant rejoint les Frères des écoles chrétiennes en 1934; la mort de jeunes mères quelques années après leurs épousailles, l’une en 1952, après avoir donné naissance à son 4e enfant, l’autre en 1964, après avoir contracté la tuberculose; le remariage de veufs et d’une veuve.
Par ailleurs, dans un album de photographies ayant appartenu à sa grand-mère paternelle décédée en 1936, l’anthropologue a trouvé des clichés de studios marqués de l’identité de photographes et de leur adresse. Ils ont révélé que, parmi ses frères et sœurs, au moins trois avaient quitté Saint-Benoît-Labre pour aller travailler aux États-Unis dans les usines de textile et dans les chantiers navals. Les villes mentionnées sur les photos aident à suivre la route de leur exil au Maine et au Massachusetts. C’est ainsi que s’est amorcé son voyage virtuel vers le Maine où sont constituées des bases de données généalogiques à partir des inscriptions sur les pierres tombales. La plaque commémorant les lieux d’établissement des Franco-Américains en Nouvelle-Angleterre, installée dans l’arrondissement historique de Sillery au bord du fleuve Saint-Laurent, n’est donc qu’un premier pas pour elle vers la route des cimetières catholiques au pays de l’oncle Sam.
En conclusion, Brigitte Garneau affirme qu’on peut poser de véritables gestes commémoratifs qui jouent un rôle identitaire, sans qu’ils soient nécessairement collectifs et publics, comme le veut la définition gouvernementale de la commémoration.
Sixième Conférence
Conférence de Catherine Ferland, historienne et directrice générale des Rendez-vous d'histoire de Québec
Croix de bois, croix de fer. Évolution du marquage des sépultures au Québec, 17e-20e siècles

La dernière conférence de la journée a été offerte par Catherine Ferland, historienne professionnelle et directrice générale des Rendez-vous d’histoire de Québec. Elle nous a entretenus de l’évolution du marquage des sépultures au Québec, de l’époque de la Nouvelle-France à nos jours. Le marquage funéraire est une tradition qui date des Romains. Ces derniers avaient le souci d’écrire sur de la matière dure le nom, l’âge et la profession des citoyens, mais pas ceux des esclaves. À l’époque médiévale, le phénomène se raréfie, car on accorde davantage d’importance à l’âme. En Nouvelle-France, avant leurs déplacements, les autochtones déterraient leurs défunts et les amenaient avec eux. Quant aux Français, il n’y avait pas de lieu funéraire dédié pour les premiers à mourir dans la colonie en 1608; l’inhumation se faisait à l’écart de l’Habitation. Le premier cimetière daterait de 1620. On le voit sur une carte de Québec, situé dans la côte de la Montagne, et représenté avec de toutes petites croix en bois, sans nom; seulement quelques sépultures sont identifiées. Même pour les gens aisés, il n’y avait pas de préoccupation de pérenniser leur nom sur un emplacement précis avant l’arrivée des Anglais.
Avec les traditions héritées de l’époque victorienne, les choses changent au XIXe siècle. On commence à placer des marqueurs dans les églises (dans la chapelle du séminaire de Québec en 1820) et peu à peu dans les cimetières. Le métal est de plus en plus employé. L’historienne donne des exemples de plusieurs dispositifs, dont des croix cerclées dans l’ancien cimetière de St-Roch en activité entre 1831 et 1854, avant l’inauguration du St-Charles. Ils préfigurent ce qui existera dans les grands cimetières-jardins ouverts au milieu du XIXe siècle, avec l’idée d’éloigner les défunts des villes. Avec eux, s’installera la pratique d’honorer les morts à l’occasion de visites déambulatoires dans ces lieux esthétiques, devant des stèles en pierre, où on lit très bien les épitaphes. Au Mount Hermon, les règlements affichés à l’entrée édictent clairement les termes de concessions et de symétrie des lots, la hauteur autorisée des enclos (pas plus de 2 pieds), l’interdiction des monuments en bois et d’éléments offensants. Disparaîtront alors les stèles en bois, souvent des œuvres d’art comme celles à Ste-Angèle de Laval, faites dans ce matériau périssable. Cette époque romantique verra le développement d’une statuaire funéraire magnifique. Des catalogues offriront les mêmes modèles que l’on retrouvera d’un cimetière à l’autre, autant au Belmont qu’au St-Charles. Les enclos familiaux répliqueront les propriétés des vivants, telles les bornes autour des maisons des riches familles bourgeoises. Dans les cimetières des campagnes, le fer sera à l’honneur, comme à St-Irénée de Charlevoix, où abondent les dentelles de fer, les croix de fer, alors que l’acier galvanisé domine au St-Charles.
Les cimetières-jardins pavent la voie à la commémoration des fondateurs, des personnalités publiques et des marchands. On honore la mémoire de Louis Hébert (1575-1627), premier colon établi en Nouvelle-France et inhumé au cimetière des Récollets. On recherche le tombeau de Champlain. Les grandes familles de marchands se font ériger des monuments exubérants comme celui de Zéphirin Paquet au St-Charles. Au Belmont, les Leclerc prennent la peine de marquer leur lot avec un petit cœur représentatif de leurs biscuits. On pose des bornes identitaires sur les sépultures des premiers ministres. Le marquage s’exprime aussi dans la restauration. Pensons au cimetière protestant Saint-Matthew régulièrement vandalisé et qui était occupé par les motards. En 1978, une petite équipe d’étudiants a nettoyé le site. À partir des registres de la paroisse anglicane, on a identifié les personnes inhumées. Entre 1985 et 2010, la ville l’a aménagé pour valoriser son importance à plusieurs égards. Transformé en parc urbain, il est aujourd’hui un modèle de restauration réussie où le marquage des sépultures est associé à une commémoration du lieu, de personnages et d’événements historiques.
Table ronde des trois dernières conférences

Une dernière table ronde est animée par Alain Tremblay, président-fondateur de l’Écomusée du patrimoine funéraire et commémoratif. Les commentaires des participant-e-s portent sur :
- L’importance que les recherches généalogiques se situent au-delà de 30 ans pour prétendre à la commémoration
- La nécessité de l’élargir aux personnes enterrées en dehors des cimetières publics (par exemple, dans les années 1780, cinq personnes excommuniées inhumées dans un cimetière privé situé sur une terre à Saint-Michel-de-Bellechasse, exhumées un siècle plus tard et rapatriées dans la partie profane du cimetière paroissial)
- La nécessité de commémorer des personnes, même en l’absence de monuments (fosse commune avant 1920 dans les cimetières paroissiaux, pratiques en temps d’épidémie, fosses temporaires, translation, déplacements de corps à la suite de travaux)
- L’importance de ne pas confondre la commémoration avec les pierres tombales, l’iconographie ou le patrimoine bâti
- Le besoin d’y réfléchir en lien avec les nouvelles formes de sépulture et de marqueurs actuelles et à venir (jardin cinéraire, dispersion des cendres en nature, certificat GPS, plantation d’arbres, coffre en carton, cimetière écologique, ossuaire)
- Le besoin d’y réfléchir en lien avec la vente et la reprise des lots (généalogie de concessions)
- L’importance de tenir compte de l’histoire du lieu, des généalogies familiales, des registres (présence irlandaise dans le cimetière de St-Séverin de Beauce)
- L’obligation de créer des partenariats (enseignants des programmes d’études internationales, élèves volontaires, marbriers locaux, sociétés d’histoire).
Voir aussi le résumé du premier volet du Forum tenu à Montréal le 28 octobre 2022 ici
Voir la déclaration finale du Forum ici