
biochimiste taphophile
Introduction
J’ai entrepris une série d’articles sur un sujet aussi important que tabou dans notre société et notre culture : la mort. Les trois articles précédents ont aussi été déposés sur ce site Web, soit :
- La mort au temps du numérique
- La biologie de la mort
- La disposition des cadavres à travers les époques et les cultures.
Mes recherches sur le sujet m’ont fait réaliser que de nombreux métiers, professions, et occupations ont une relation directe ou indirecte avec la mort. Y compris certains métiers dont je ne soupçonnais même pas l’existence. J’ai principalement relevé les activités rémunératrices, d’où le titre, qu’elles soient exercées à temps plein ou plus sporadiquement, mais j’ai aussi considéré le travail de bénévoles, moins connu, mais vital. Bref, j’ai essayé de présenter la contribution de tous ceux qui côtoient la mort de près ou de loin.
Je me suis inspiré pour cet article du livre de Haley Campbell « All the Living and the dead », paru en 2022, une source précieuse, très riche d’informations et magnifiquement écrite.
Question de mettre un peu d’ordre dans cette liste, je l’ai divisée plus ou moins selon le moment où l’activité est principalement effectuée. Donc avant, pendant, peu après, longtemps après la mort. J’insérerai de courtes notes sur chaque item et conclurai avec une discussion sur les défis humains associés à ces « métiers » de la mort.
Avant


- Les équipes de prévention du suicide.
Le but est bien évidemment d’éviter la mort, mais il faut réaliser que le personnel et les bénévoles qui œuvrent courageusement dans ces centres doivent aussi faire face à des échecs, et en subir les contrecoups, et se retrouver dans une situation de deuil. - Les membres des équipes de soins.
Les traitements médicaux ne sont pas toujours réussis, c’est inévitable, donc les équipes de soins doivent elles aussi affronter la mort des patients à leur charge. Dans certaines circonstances, dans les cas de décès imprévus ou particulièrement dramatiques, le choc peut être psychologiquement violent. Surtout quand il s’agit de jeunes enfants et que le soignant ou la soignante est lui-même parent. - Le personnel des Centres de soins palliatifs.
Dans ce cas, tous les patients qui y sont admis vont décéder, sauf exception, dans un délai de quelques semaines. Certains de ces centres ne sont pas dans des hôpitaux, mais dans des maisons spécialisées consacrées exclusivement à cette mission. Un travail certainement difficile, mais tellement utile. Encore plus difficile : les soins palliatifs pour enfants. Certains médecins en font même leur spécialité. Un travail admirable. - Le personnel des salles d’accouchement.
Une naissance est normalement un événement heureux, mais pas toujours. Le bébé peut être mort-né ou très peu viable, ou l’accouchement peut finir en catastrophe. Dans certaines unités il peut même y avoir des membres des infirmières affectées spécifiquement à prendre soin de la mère, car c’est ainsi qu’il faut l’appeler malgré tout, vivant un moment difficile. J’ai été très impressionné de la description et je l’avoue très étonné de l’importance de cette fonction telle quelle est expliquée dans un livre paru en 2022, écrit par Haley Campbell : « All the Living and the dead », (voir Référence 1) qui décrit justement plusieurs « métiers de la mort » dont celui-ci de façon très humaine tout en fournissant énormément d’informations. - Les médecins procédant à l’aide médicale à mourir.
Ainsi que le personnel qui les assiste. Ce procédé tend à se répandre assez rapidement au Québec, plus que bien d’autres régions du monde, et son application sera progressivement élargie à des cas qui n’y ont pas droit présentement. C’est un travail qui demande beaucoup de tact, de respect, de savoir-faire et surtout de rigueur, car la marche à suivre est étroitement encadrée par les règlements de la loi et l’éthique médicale, comme il se doit. - L’équipe de stabilisation des patients destinés à devenir donneurs d’organe.
J’ai brièvement expliqué la procédure en question dans un article précédent (la biologie de la mort). Il s’agit, après la mort cérébrale, de continuer à maintenant la circulation sanguine et la respiration jusqu’à ce qu’au moment où l’organe est prélevé et acheminé à un receveur. C’est aussi un travail délicat, car il est crucial que la famille du « décédé » comprenne bien ce qui se passe et l’accepte. J’écris « décédé » entre guillemets, car même si le donneur est biologiquement et légalement décédé, il ne l’est pas vraiment aux yeux de certains ou du moins n’en a pas l’air, ce qui peut être perturbant pour l’entourage. Mais on ne saurait trop insister sur l’importance de ces dons, dont le nombre est présentement insuffisant en regard des besoins.


- Fabricants et distributeurs de matériel funéraire.
Y compris les pierres tombales, mais aussi tout ce que les maisons funéraires requièrent. Le cercueil, les urnes, etc., mais aussi les produits utilisés par les thanatologues. Il existe au Québec une importante firme de ce type, soit « Victoria co. ». Les pierres tombales proviennent de divers autres fabricants qui approvisionnent aussi les maisons funéraires. - Ambulanciers paramédicaux (paramédics)
Il est inévitable que les paramédics, se retrouvent, à un moment ou un autre, en contact avec des personnes très malades, mourantes ou décédées. Et pas toujours en bon état, lorsqu’il s’agit de victimes d’accidents, voire partiellement en décomposition. Le traumatisme vécu par ces travailleurs peut être très difficile à surmonter. Le stress causé par l’urgence de la situation et par la conduite hasardeuse de leur véhicule est à considérer. Un métier difficile.
Pendant
- Policiers
Un policier peut certainement être confronté à la mort dans son travail, même si n’est qu’occasionnel. Et lui aussi doit y être bien préparé, non seulement pour les détails techniques de son travail mais aussi pour affronter les défis psychologiques de son intervention quand il se retrouve tout près d’un individu décédé. Et encore bien plus si ce policier est celui qui a dû l’abattre. Inutile de dire que l’expérience peut être extrêmement perturbante. - Bourreaux
Ce métier, car c’en est bien un, n’est plus pratiqué au Canada, mais il persiste près de chez nous, aux États-Unis où il connaît même une recrudescence. Plusieurs pays y ont cours, notamment la Chine, l’Arabie saoudite et l’Iran.

- Militaires pendant les conflits armés.
Il ne faut tout de même pas se leurrer, les militaires en guerre tuent des militaires de l’autre camp, et même des civils (notamment en Ukraine). Il ne s’agit pas de meurtre, selon les conventions de la société, mais une mort est une mort. - Assassins en tout genre.
Il y a bel et bien mort d’un ou de plusieurs êtres humains ici et donc je me croyais justifié de mentionner ce genre d’événement dans ma liste. Une catégorie très spéciale : les tueurs à gages. Et dans ce cas il s’agit bel et bien d’un métier de la mort. Peut-être le plus rémunérateur, d’ailleurs, mais ces individus, exclusivement masculins à ma connaissance, ont généralement une carrière plutôt courte, qui finit mal.

Peu Après

- Pathologistes et techniciens, salles d’autopsie hospitalières.
Les autopsies en milieu hospitalier ne sont pas aussi fréquentes qu’autrefois. C’est probablement grâce à la précision accrue des diagnostics, basés non seulement sur l’étude clinique, mais sur les très nombreux tests de laboratoire et d’imagerie médicale à la disposition des cliniciens. La cause du décès est donc le plus souvent évidente. Mais pas toujours, et certaines autopsies sont toujours requises. Comme le contact avec le cadavre est immédiat, pour ainsi dire intime, le personnel des salles d’autopsie doit surmonter, surtout en début de carrière, une répugnance et une crainte très naturelles. - Personnel des centres de cryoconservation.
La cryoconservation consiste à placer le corps à très basse température, en espérant qu’on pourrait éventuellement, beaucoup plus tard, décongeler et ranimer le défunt. Cette technique n’est toujours pas fonctionnelle, il faut le préciser, et elle tend à disparaître. Mme Campbell dans son livre nous rapporte une discussion très nuancée qu’elle a eue avec le directeur d’un centre de genre. Une bonne source d’Information pour qui voudrait toujours y croire. Malgré tout, le mythe de Walt Disney a la vie dure. - Personnel des services post-désastres majeurs.
Je ne savais même pas, avant d’effectuer mes recherches, que ce genre de firme existait. Elles sont pourtant très importantes. La compagnie Kenyon, basée en Angleterre en est un excellent exemple. Une compagnie très discrète, mais souvent sollicitée pour coordonner à tout point de vue les services après désastre, comprenant l’identification des cadavres, mais aussi la prise en charge des familles des défunts, les communications avec les médias et bien d’autres services. Un genre de « tout inclus » après désastre. La compagnie a à sa disposition une grande variété de professionnels. Les défis à relever sont immenses, bien souvent. Leur site Web :
https://www.kenyoninternational.com/ mérite certainement une visite.
Bien Après
- Personnel des maisons funéraires
Comprenant entre autres le directeur, thanatologue (embaumeur), porteurs, représentants (vente et service). C’est le domaine qui nous vient d’abord à l’esprit quand il est question de « métiers de la mort ». L’intérêt de ces firmes est leur capacité de prendre en main toutes les démarches qui incombent aux survivants, et de fournir la plupart des services requis. C’est aussi une importante industrie : des milliards de dollars par année en Amérique. Les directeurs funéraires ont dû s’adapter aux nombreux changements des mentalités des citoyens en rapport avec la mort, surtout dans les dernières décennies. Ils ont dû se conformer aux contraintes imposées par l’épidémie de la COVID-19, un vrai défi. Ils doivent maintenant aussi s’adapter aux nouvelles sensibilités écologiques de la population, un facteur qui prend de plus en plus d’importance.

- Prêtres et autres officiants religieux
C’est-à-dire ceux qui officient aux cérémonies, et surtout les funérailles religieuses, mais également ceux qui lisent au salon funéraire des textes religieux, à la demande des familles. Ils peuvent aussi lire ou faire lire des témoignages ou des anecdotes à propos du défunt. - Organisateurs de cérémonies commémoratives
En plus des animateurs religieux, il existe maintenant des firmes qui peuvent prendre en main l’organisation complète de cérémonies commémoratives ou de réunions d’hommage. Cet événement a normalement lieu un certain temps après les funérailles, une fois que la phase la plus intense du deuil est passée. Elle est vraiment une célébration de la vie de la personne décédée, et a donc souvent un caractère de véritable fête.

- Préposés à la crémation ou autres dispositions des cadavres.
Ce service est fourni dans des installations spécialisées approuvées et inspectées par les autorités. Il est d’autant plus important qu’il est maintenant utilisé pour la majorité des défunts, au Québec (environ 70%). Il faut noter qu’il existe maintenant des alternatives à la crémation et l’inhumation telles que : aquamation, compostage, etc. J’ai abordé ce sujet en détail dans un de mes articles sur ce site Web (La disposition des cadavres à travers les époques et les cultures). Là aussi les préoccupations écologiques vont intervenir, ce n’est qu’une question de temps.

- Personnel des cimetières.
Comprenant entre autres : gestionnaire, fossoyeurs, préposés à l’entretien. La protection du patrimoine est de plus en plus difficile et c’est encore pire pour le patrimoine funéraire. Ce secteur souffre d’un manque chronique de ressources. Les cimetières relèvent des fabriques des paroisses. Comme la pratique religieuse est en décroissance, les revenus le sont tout autant, d’autant plus que les nouveaux « occupants » se font moins nombreux. Les fonds pouvant être consacrés aux cimetières diminuent, pour diverses raisons. Les fabriques des paroisses sont souvent forcées de fusionner avec celles d’autres localités environnantes et elles peinent à fournir les services d’entretien de leurs cimetières. On se demande même si les cimetières ne devraient pas relever plutôt des municipalités. Il faut dire aussi que les survivants ne montrent pas beaucoup d’intérêt à garder en bon état les pierres tombales de leurs défunts, tâche que le personnel des cimetières ne peut plus faire. Il y aurait place pour du bénévolat, ici, de la part des groupes intéressés au sort des cimetières. - Graveurs de pierre tombale.
Un métier où la relève semble difficile à trouver. On parle ici à la fois des graveurs employés par les fabricants de pierres tombales ou référés par les maisons funéraires, mais aussi de certaines firmes offrant des services d’entretien et de restauration des pierres. Ce domaine fait de plus en plus usage des nouvelles technologies telles que la gravure au laser, ce qui ouvre des possibilités fort intéressantes. - Fabricants et distributeurs d’objets souvenirs des défunts.
Un domaine en pleine croissance, que j’ai aussi décrit dans le premier de mes articles. On fait preuve de beaucoup d’imagination pour proposer de nouveaux produits, même si le bon goût n’est pas toujours au rendez-vous. À suivre surtout les développements des produits numériques, prometteurs mais controversés. Voir : La mort au temps du numérique. - Fabricants de masques funéraires
C’est en fait un art ancien, et très difficile, mais j’ai été surpris d’apprend qu’il existe encore des artisans pouvant fabriquer ces masques. Mme Campbell consacre un chapitre à ce sujet, basé sur une rencontre avec un tel fabricant de masques. Très surprenant.
Oui, les fleuristes offrent bien d’autres services que le montage des couronnes funéraires et autres hommages floraux. Mais c’est tout de même une part non négligeable de leur chiffre d’affaires. D’ailleurs on remarque souvent la présence d’un tel commerce à proximité des cimetières et des maisons funéraires. Ce n’est sûrement pas une coïncidence.
MÉDICAL ET MÉDICO-LÉGAL, À DIVERS MOMENTS.

- Préparation et entreposage des cadavres à des fins de recherche ou de formation
On parle surtout ici des corps qui, pour utiliser l’expression consacrée, ont été « légués à la science ». Le plus souvent, c’est pour la formation des étudiants en médecine. Il arrive aussi que des chirurgiens, par exemple, requièrent des parties du cadavre pour se familiariser avec une intervention rare ou nouvelle. La gestion, si on peut dire, de toutes les pièces peut devenir vraiment complexe. Le livre de Mme Campbell consacre un chapitre à une visite du service des cadavres confiés à la réputée Clinique Mayo, un des plus importants départements du genre en Amérique. - Les fermes de corps.
Ou « Body Farm ». C’est un peu cru comme désignation, mais ce sont des centres de recherche sur la décomposition des cadavres à l’air libre dans des parcs clôturés (heureusement!). Ces recherches profitent surtout aux enquêteurs des forces policières qui ont besoin de connaître le moment précis d’un meurtre, par exemple et pour savoir si le corps a été déplacé. Il en existe justement un au Québec, à Nicolet, pour être précis. - Les enquêteurs procédant à l’examen des sites de crimes.
Ils utilisent des méthodes scientifiques de plus en plus précises, surtout depuis le développement des analyses d’ADN. Mais ils exercent souvent leur métier dans des conditions pénibles. - Médecins procédant à la constatation officielle d’un décès.
Cette constatation doit légalement être faite pour tout décès, à l’hôpital ou ailleurs. La plupart des médecins sont habilités à le faire. - Spécialistes en médecine légale.
La médecine légale est la spécialité qui s’intéresse à déterminer la ou les causes de lésions d’une victime, et en particulier lorsque le décès est suspect. Plusieurs types d’experts y travaillent, mais ce sont tous au départ des pathologistes. - Préposés aux morgues des centres des sciences judiciaires et de médecine légale.
Leur travail est semblable à ce qui a été décrit pour les autopsies en milieu hospitalier. Mais il s’y ajoute plusieurs degrés de difficulté supplémentaires. Les préposés doivent rencontrer les proches, une tâche rendue encore plus délicate du fait qu’il s’agit le plus souvent d’une mort inattendue, dramatique, donc d’une tragédie humaine. Ils doivent aussi respecter un protocole stricte. Radio-Canada a réalisé un reportage à ce sujet, « La mort au quotidien » après avoir rencontré des employés des morgues de Montréal et de Québec, des témoignages particulièrement intéressants. Un véritable « métier de la mort » bravement assumé par des gens qui aiment leur travail. À lire.
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/4778/morgue-quebec-montreal-mort-enquete-deces-coroner-medecine-legale
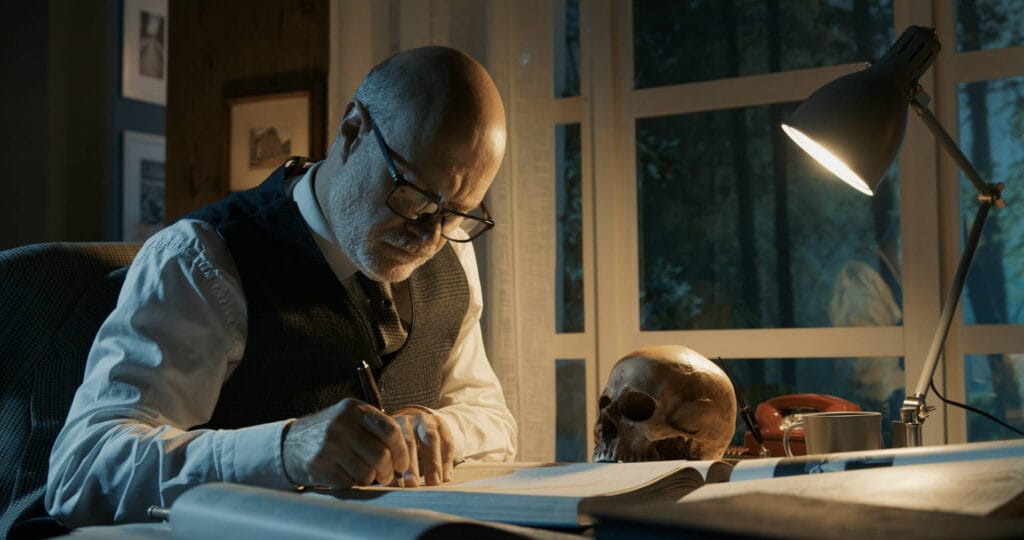
- Coroners.
Et bien sûr il faut mentionner les coroners, qui sont des médecins ou des avocats qui enquêtent sur les morts dont la cause n’est pas évidente. Ils peuvent aussi diriger des enquêtes publiques, par exemple par suite de désastres importants. Il faut rappeler que leur rôle fondamental n’est pas de trouver des coupables, mais bien de voir comment éviter que les désastres se reproduisent, ou tout au moins pour que les conséquences néfastes en soient amoindries. - Préposés au nettoyage des scènes de crime.
Je n’avais jamais pensé qu’un métier aussi spécial puisse exister, mais c’est le cas. Les meurtres, suicides et autres morts violentes peuvent faire de sérieux dégâts dans les lieux où ils se produisent. Remettre le lieu en état n’est pas une mince tâche, dans bien des cas, et demande d’avoir vraiment le cœur solide. C’est pourquoi certaines personnes s’en sont fait une spécialité. Chapeau! - Notaires et liquidateurs.
Les notaires ne se retrouvent pas en présence des défunts, bien sûr, mais la rédaction d’un testament est tout de même reliée à la mort d’une personne, comme l’est la lecture du testament devant les légataires. Le liquidateur, quant à lui, réalise l’exécution des dernières volontés du défunt et prend en charge la disposition des avoirs de celui-ci.
Bénévolat

Certaines activités reliées à la mort sont assumées non pas par des professionnels, mais par de simples bénévoles. Leur rôle est pourtant précieux. Quelques exemples.
L’aide au deuil périnatal. Cet événement malheureux est loin d’être rare, se produisant dans près de 20 000 couples par année, au Québec. On réalise de plus en plus que de l’aide psychologique ou simplement humaine doit être fournie dans ces moments difficiles. Le personnel hospitalier y contribue, les psychologues également, mais il existe des regroupements de bénévoles tels que « Les Perséides » qui y travaillent aussi.
L’accompagnement des mourants. Dans beaucoup d’hôpitaux, des équipes de bénévoles assistent le personnel des services de soins palliatifs, par exemple en accompagnant les patients et leur famille. Des organismes indépendants tels que « Albatros » se sont donné comme mission de former et encadrer ces bénévoles.
La protection et la mise en valeur des cimetières. Je m’en serais voulu de ne pas mentionner les bénévoles qui œuvrent à entretenir les cimetières, à les faire connaître, notamment en inventoriant les pierres tombales et les informations qui s’y trouvent. Il existe même des groupements du genre « Les Amis du cimetière X » qui se partagent le travail.
Conclusion
J’ai été moi-même surpris du nombre de personnes qui, directement ou indirectement, exercent des activités rémunérées ou non en rapport avec la mort et ses suites. La question qu’on pose immanquablement quand on a l’occasion de converser avec ces gens est : comment faites-vous pour effectuer un travail si difficile sur le plan humain? Comment faites-vous pour ne pas être vaincu par l’horreur, l’infinie tristesse de ces situations tellement pénibles? Et immanquablement on nous répond : Malgré tout, on finit par s’y habituer et à se bâtir une carapace pour survivre, tout en tâchant de rester empathique. Un équilibre toujours difficile. Mais on nous dit aussi que dans certaines situations cette carapace est percée, en particulier si ça concerne des enfants ou des proches.
Ils méritent notre admiration, je les remercie tous du fond du cœur.
Références
1.L’indispensable référence: assez complet. L’auteure a visité toutes les endroits qu’elle décrit et interrogé le personnel, toujours avec une approche très humaine.
From Embalmers to Executionners, and Exploration of the People Who Have Made Death Their Life’s Work. Hayley Campbell. Éditeur : St-Martin Press, New York, 2022. (Disponible en anglais seulement).
Sur le même sujet, mais d’un angle différent, avec une pointe d’humour.
2.Maccabées. Mary Roach. Calmann-Lévy, Paris 2005.
Deux publications récentes (2022) sur l’ensemble de mes articles sur la mort.
3.Mortels : ce que nous révèle la science. Une enquête réalisée par la rédaction de Science et Vie, coordonnée par Philippe Bourbeillon Éditeur Alision, Paris 2022.
4.La mort : ce que la science en dit. Dans la série « Les indispensables » de la revue Sciences et Avenir. Octobre 2022.





