Chronique du Bioarchéologue:
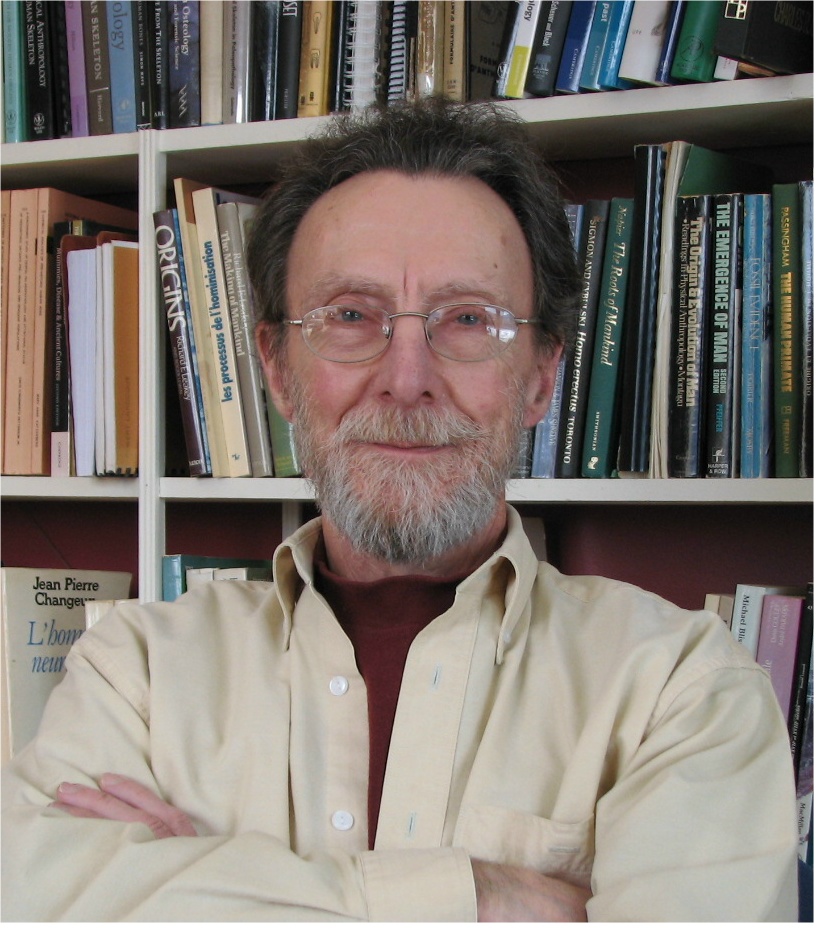
Bioarchéologue
Les coutumes de jadis entourant la mort sont relativement bien connues grâce aux descriptions que nous en trouvons dans les textes anciens. Du moins, connaissons-nous, dans leurs grandes lignes, les différentes étapes des rituels mortuaires (préparation du corps du défunt, veillée mortuaire, cortège funèbre, etc.). Cependant, une fois le corps arrivé au cimetière, les archives se taisent presque. Il n’est donc pas toujours facile de se figurer comment était utilisé l’espace de nos cimetières autrefois et quelles étaient les dernières attentions que les vivants ont apportées à leurs morts. C’est alors que l’archéologue prend la relève de l’historien.
La contribution de l’archéologie à nos connaissances sur les rituels mortuaires se situe donc à deux niveaux. Sur le plan collectif, elle permet de préciser comment les défunts étaient disposés les uns par rapport aux autres dans le cimetière. Dans la un artcicle précedent intitulé les dessous de nos cimetières (été 2017), nous avons suivi l’archéologue dans son exploration. On a vu, entre autres choses, que les fosses étaient réparties d’une manière relativement désordonnée à comparer aux cimetières actuels et que l’orientation et la profondeur des sépultures pouvaient mettre en évidence différentes phases d’utilisation du cimetière.
Au niveau individuel, l’archéologie aide à documenter le traitement qui était réservé aux défunts. Étaient-ils inhumés en pleine terre ou en cercueil? Ce dernier possédait-il des poignées et des charnières? Y trouve-t-on des objets? Comment les avant-bras du défunt étaient-ils disposés? À tous ces égards, note-t-on des différences selon l’âge ou le sexe du défunt? À nouveau, c’est l’archéologue qui peut le mieux répondre à ces questions. Continuons donc à le suivre dans sa quête d’informations sur les modes d’inhumation d’autrefois.
Les cercueils
En l’absence de traces de bois de cercueil, l’archéologue sera tenté de croire que le défunt fut inhumé en pleine terre. Mais la découverte de quelques clous de cercueil suffira à éliminer cette possibilité. Même s’il n’y a ni bois ni clous – ceux-ci peuvent aussi être entièrement détruits –, la coloration et la texture du sol peuvent trahir une inhumation en cercueil. Grâce à ces indices , on peut avancer que nos défunts étaient très probablement tous mis en terre dans un cercueil. Seules les victimes d’épidémie, qui étaient souvent ensevelies à la hâte dans une fosse commune, auraient été inhumées en pleine terre.
Bien que le bois et les clous soient périssables, nombre de cercueils sont en assez bon état pour en reconstituer la facture. Jusque vers le milieu du XIXe siècle, celle-ci était très rudimentaire, les cercueils n’étant en général rien de plus qu’une boîte avec un couvercle cloué. La plupart n’avait ni quincaillerie (poignées, charnières) ni éléments ornementaux (cache-clous). Exceptionnellement, une plaque de métal, sur laquelle était sans doute inscrit le nom du défunt, est présente sur le couvercle. Tout aussi rares sont les cercueils doubles, lorsque delui-ci était mis dans une plus grande boîte.
La forme à six côtés – avec un élargissement aux épaules – était nettement dominante (photo 1). C’était le type le plus courant en Amérique du Nord avant que le cercueil rectangulaire ne devienne à la mode vers le milieu du XIXe siècle. En réalité, il serait plus exact de dire redevienne, car la forme rectangulaire était en vogue jusque vers 1650, avant qu’elle ne soit supplantée par celle hexagonale. La rareté des sépultures remontant à la première moitié du XVIIe siècle peut créer l’illusion que la forme hexagonale était antérieure à la forme rectangulaire. Une troisième forme, beaucoup plus rare, a été utilisée : la forme trapézoïdale, qui peut être considérée comme un cas particulier de la forme rectangulaire.
Si cette dernière est maintenant la norme, les cercueils hexagonaux continueront d’être utilisés au Québec jusque dans les années 1950-1960. Ils auraient été réservés aux individus de statut social modeste. Curieusement, on se serait attendu au contraire. De fait, la forme hexagonale étant plus compliquée à réaliser, elle est moins économe en main-d’œuvre, de même qu’en bois.
La disposition du défunt
Nos défunts étaient tous mis en cercueil dans la position dite en décubitus dorsal, c’est-à-dire allongée sur le dos. Très exceptionnellement, un corps repose sur le côté. C’est sans doute accidentel : il aurait bougé lors de la manipulation du cercueil, en particulier au moment de sa mise en terre. La position des avant-bras est, quant à elle, extrêmement variable. Ils peuvent être allongés le long du corps ou repliés sur le bassin, le ventre, l’estomac ou la poitrine, et il est courant que les deux avant-bras ne soient pas dans la même position (photo 2).
L’explication à cette variable n’est pas évidente. Il ne semble pas y avoir de lien avec l’ancienneté des décès. Cependant, il peut arriver que, dans un même cimetière, une position donnée soit partagée par une majorité d’individus du même sexe ou d’un même groupe d’âge. Y avait-il donc des règles qui régissaient la disposition des avant-bras? Si oui, pourquoi y a-t-il toujours des exceptions? Il n’y a pas de réponse simple à ces questions, chaque cimetière semblant être un cas particulier.

Les artefacts
Les objets personnels les plus abondants qu’on retrouve dans les cercueils sont des pièces vestimentaires, surtout des boutons, beaucoup plus rarement des boucles et des agrafes (photo 3). Quelques dizaines de sépultures du cimetière Saint-Antoine (1799-1854), à Montréal, en contenaient. Viennent ensuite les objets de piété, tels les médailles et, dans une moindre mesure, les croix et crucifix et les chapelets, présents dans moins d’une vingtaine de cercueils au cimetière Saint-Antoine (photo 4).
Dans tous les cimetières antérieurs à la deuxième moitié du XIXe siècle, les bijoux et objets de parure constituent la catégorie d’artefacts la moins bien représentée.


Par exemple, toujours au cimetière Saint-Antoine, sur les quelque 350 sépultures qui n’avaient pas été exhumées après sa fermeture, seulement cinq ont livré de tels artefacts (photo 5 ). L’archéologie vient donc mettre à mal une croyance populaire voulant que les défunts fussent habituellement inhumés avec des objets de valeur qui leur étaient chers. Encore plus rarement trouve-t-on des objets d’utilité quotidienne, comme des pièces de monnaie ou des couteaux de poche, probablement oubliés dans les poches de vêtements du défunt.

Dans plusieurs cimetières, les artefacts les plus nombreux ne sont pas des objets personnels proprement dits : ce sont des épingles. Habituellement faites de cuivre ou de laiton, elles servaient sans doute à tenir en place les pans d’un linceul qui enveloppait le défunt. Lorsque présentes dans un cercueil, il est donc tentant de croire que le défunt était nu. C’est ainsi que dans l’annexe réservée aux enfants du cimetière de Sainte-Anne-de-la-Pérade (voir l’article citécihaut, été 2017), des épingles ont été récoltées dans toutes les sépultures, mais aucune ne contenait de bouton. Dans d’autres cimetières, ce sont plutôt les sépultures féminines qui livrent des épingles, mais aucun bouton. Mais il est aussi fréquent que des sépultures contiennent à la fois des boutons et des épingles. S’il semble y avoir parfois un lien avec l’âge et le sexe des défunts, aucune règle simple ne peut être formulée. Comme pour la position des avant-bras, chaque cimetière doit être traité au cas par cas.
La reconstitution des modes d’inhumation d’autrefois n’est qu’un aspect du travail du bioarchéologue. L’autre aspect a trait à l’analyse des restes humains. Comme nous le verrons dans un prochain bulletin, les analyses ostéologiques peuvent révéler des choses étonnantes et insoupçonnées sur la vie de nos ancêtres.
À suivre…







